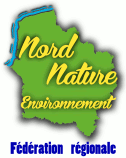 |
Info veille |
le 17/11/2011 : Communiqué de presse de INRA - GIP ECOFOR - RMT AFORCE
Forêts et changement climatique : apports de la recherche sur la vulnérabilité et conséquences pour la gestion de la forêt française
Les forêts, par leur longévité,
sont inévitablement exposées à la variabilité
et aux évolutions du climat. En outre, malgré leur contribution
à la lutte contre l’effet de serre, le changement climatique
ne pourra être évité. Il est donc important d’étudier,
dans une perspective à long terme, comment les forêts vont
subir le changement climatique et, éventuellement, y résister.
Des chercheurs de l’Inra et de plusieurs universités, ont coordonné,
durant les cinq dernières années, des projets de recherche
sur les questions de la vulnérabilité des forêts au
changement climatique. Ils viennent d’en présenter les résultats
au cours d’un colloque qui s’est déroulé le 17
novembre 2011 à Paris. Leurs conclusions sont convergentes : les
forêts sont et seront soumises à des sécheresses plus
fréquentes, longues et sévères. Selon les régions
et les essences, la vitalité et la productivité des arbres
seront affectées dans un futur proche ou plus lointain. Ainsi des
indications précieuses sont données aux gestionnaires pour
traiter les problèmes là où ils se manifestent déjà,
et améliorer pour l’avenir la résistance de la forêt
française selon les régions et essences susceptibles d’être
touchées.
Grâce à des financements de l’Agence Nationale de la
Recherche (ANR), des chercheurs de l’INRA, de plusieurs universités
et de nombreux autres organismes, ont pu réaliser des observations,
expérimentations et analyses originales sur des écosystèmes
forestiers : mesure de la croissance passée et présente des
arbres, examen des effets d’une réduction de la quantité
de pluie reçue par la forêt, étude des conséquences
d’autres facteurs de vulnérabilité, modélisation
des impacts du changement climatique sur la végétation. Ces
travaux ont été conduits dans le cadre de quatre projets différents
: dans DRYADE, les chercheurs ont étudié des cas de dépérissements
consécutifs aux sécheresses des années 2003 à
2006 ; dans DROUGHT+, c’est l’adaptation des écosystèmes
méditerranéens à une réduction de la précipitation
qui a été étudiée ; quant aux projets QDIV et
CLIMATOR, ils ont permis de préciser les impacts futurs de différents
scénarios climatiques régionalisés par les climatologues.
Des résultats convergents et complémentaires
Les observations passées comme présentes et les modélisations
de l’évolution future sont toutes convergentes : les écosystèmes
forestiers sont et seront soumis à des sécheresses de plus
en plus fréquentes, longues et sévères pour les peuplements
forestiers, influençant leur santé et leur productivité.
La vulnérabilité est particulièrement élevée face aux sécheresses récurrentes ou en cas d’interaction entre sécheresse et attaques de parasites (scolytes, chenilles défoliatrices). La capacité de récupération après les crises est variable selon les arbres et leurs ensembles qu’on nomme peuplements, selon aussi l’intensité de l’impact et les propriétés du sol. Il n’a pas été démontré de manière systématique que les dépérissements étudiés pouvaient être attribués à la dérive climatique du siècle écoulé. Cependant, des pertes de croissance durable et des mortalités anormales sont historiquement observées après chaque épisode de sécheresse extrême. En outre, certaines maladies comme l’oïdium du chêne sont liées aux conditions thermiques. Leur développement augmente la vulnérabilité des arbres aux aléas climatiques et pourraient avoir un rôle bien plus important dans un contexte de réchauffement global.
En contexte méditerranéen, les ressources en eau sont peu prévisibles. Les espèces étudiées (chêne vert, pin d’Alep) ont montré une grande capacité à modifier leur architecture et leur feuillage pour faire face à une réduction prolongée de la pluviométrie, réduisant ainsi leur vulnérabilité.
La répartition sur le terrain des essences
feuillues et résineuses, leur productivité ou la restitution
d’eau au milieu seront affectées, quelles que soient la complexité
des modèles d’impacts et la diversité des scénarios
climatiques étudiés. Certaines régions (sud, sud-ouest)
seront touchées dès le futur proche (2050), mais la plupart
des autres régions le seront dans un futur plus lointain (2100).
Tous les modèles indiquent une extension vers le nord de l’aire
abritant des espèces méditerranéennes (comme le chêne
vert), et une régression du pin sylvestre dans sa limite sud. Pour
le hêtre, en revanche, des divergences apparaissent entre les modèles
d’impact, pour sa répartition et sa productivité.
Des acquis pour la gestion des forêts françaises
Le champ des futurs possibles balayés par les scénarios et
les acquis des dépérissements récents issus de ces
recherches apportent aux gestionnaires des éléments pour accompagner
dès aujourd’hui la gestion de crises sanitaires. Pour proposer
des actions d’adaptation de la forêt française selon
les grandes zones climatiques et les groupes d’essences, forestiers
et chercheurs travaillent ensemble au sein du RMT Aforce (Réseau
Mixte Technologique consacré à la production d’outils
pour aider les gestionnaires à préparer les forêts au
changement climatique).
Le programme Dryade par exemple, qui associait chercheurs, partenaires de la gestion et de la surveillance de la santé des forêts, a conduit à la publication d’un guide de gestion des forêts en crise sanitaire. Ce guide s’adresse à l’ensemble des acteurs concernés, les pouvoirs publics, la communication, les gestionnaires, les propriétaires, les techniciens et la filière forêt-bois. Des critères ont été identifiés pour caractériser les différents stades d’une crise sanitaire en forêt. Plusieurs indicateurs quantitatifs sont proposés pour aider les gestionnaires à passer d’une gestion courante à une surveillance accrue, puis à une gestion de crise. Ces indicateurs permettent aussi d’objectiver l’entrée et la sortie de crise, accompagnées chacune de procédures réglementaires précises. Ce guide, élaboré pour gérer les conséquences des évènements climatiques exceptionnels en forêt, contribue pleinement aux recommandations du Plan National d’Adaptation au Changement Climatique pour la forêt.
Un « Livre vert » a par ailleurs été élaboré dans le cadre du projet Climator à l’intention de l’ensemble des acteurs du monde agricole et forestier. Son volet « forêt » permet d’appréhender les impacts du changement climatique sur les surfaces boisées françaises au travers de simulations et propose des pistes sylvicoles pour y faire face.
Les incertitudes, analysées et quantifiées, restent cependant fortes en particulier dans la régionalisation des aléas futurs, la capacité d’adaptation des écosystèmes, ou encore dans notre aptitude à modéliser leur fonctionnement. Les recherches menées ici contribuent à prioriser les actions des gestionnaires forestiers en indiquant quelles sont les situations les plus vulnérables selon la zone climatique, l’essence et le milieu naturel local. Ces résultats permettent aux gestionnaires d’innover dans leurs pratiques sylvicoles, ainsi que dans leur sélection d’essences ou de provenances de manière à trouver le bon compromis entre productivité et durabilité de systèmes pour lesquels l’eau risque de manquer.
Les références : http://www.inra.fr/presse/foret_et_changement_climatique__1