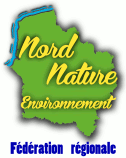
|
Bulletin
trimestriel |
La vitesse généralisée (suite)
Article de Alain Vaillant
Cet article est la suite de celui portant le titre "La vitesse généralisée" qui a été publié en 2001 danbs le bulletin n° 102 de la Fédération Nord Nature
Dans son ouvrage intitulé " Energie et Equité ", publié
en 1975 aux édition du Seuil, Ivan Illich a défini le concept
de vitesse généralisée : le rapport de la distance parcourue
au temps que l’on met à la parcourir. Cette définition n’a
rien de révolutionnaire, sauf que, dans le " temps que l’on
met à la parcourir ", il y a le temps effectif du déplacement
et le temps que l’on passe à se donner les moyens du déplacement.
Exemple : lorsque je parcours 100km en 1heure avec mon automobile,
ma vitesse mécanique est de 100/1 = 100 km/h. Mais, par ailleurs, mon
véhicule me coûte (en tout) 0,4€/km et mon revenu horaire
est de 10€/h. Mon déplacement de 100 km me coûte 40 €
et je dois donc travailler 4h pour gagner l’argent correspondant. Finalement,
je mets 5h (une sur la route et 4 au travail) pour faire ces 100km. Ma vitesse
généralisée est donc de 100/5 = 20 km/h.
A travers cet exemple il est clair que la vitesse généralisée
ajoute à la vitesse mécanique une notion de revenu horaire de
la personne qui fait le déplacement et le coût, au kilomètre,
du moyen de transport utilisé. Par ailleurs, si le coût du transport
est nul (rersp. proche de zéro), la vitesse généralisée
est égale(resp ; presque égale) à la vitesse mécanique.
C’est à dire que la vitesse généralisée mérite
bien son qualificatif « généralisée », et on
sait déjà que l’enrichissement du concept se fait dans le
domaine socio-économique.
Etude : Il peut être intéressant
d’exprimer la vitesse généralisée (Vg) en fonction
de la vitesse mécanique(Vm), du coût (c) du moyen de transport
en €/km, le salaire (s), ou revenu, horaire en €/h et la distance
(d) parcourue en km.
Pour avancer dans l’étude de cette
formule, on va successivement faire 2 hypothèses simplificatrices :
1ère hypothèse : on suppose que « c »,
c’est à dire le coût au km, est constant (cad qu’il
ne dépend pas de la vitesse mécanique).
2ème hypothèse (un peu plus réaliste)(1) :
on suppose que le coût au km(« c ») est une fonction croissante
de la vitesse mécanique (« Vm »). Les calculs donnent :
Ces calculs ont été vérifiés par Monsieur Jean
Marc Sarteel
Dans la première hypothèse, on obtient alors(2) un résultat singulier : la vitesse généralisée, qui augmente avec la vitesse mécanique, ne peut pas dépasser la valeur s/c . C’est à dire que la vitesse généralisée est bornée supérieurement par une valeur qui dépend uniquement des données socio-économiques ! Il est à noter que la simplicité du résultat permet à tout un chacun de calculer sa vitesse généralisée maximale.
Dans la deuxième hypothèse, le résultat du calcul montre que pour un individu ayant un certain revenu horaire et un moyen de transport donné, lorsque sa vitesse mécanique augmente à partir de zéro, sa vitesse généralisée augmente dans un premier temps puis ensuite diminue vers 0 !. Cela est vrai même avec une augmentation linéaire faible de « c » en fonction de « Vm » (coefficient k positif et proche de zéro)
On est loin des marchands d’automobiles qui utilisent
la vitesse mécanique (explicitement ou implicitement) pour vendre leur
marchandise aux jeunes et en plus, il ne s’agit pas alors de vitesse moyenne
mais bien de vitesse de pointe. Mais là, nous ne sommes plus dans le
domaine des transports mais dans celui de l’achat d’une image de
puissance à laquelle s’identifie l’utilisateur
(1) : cette hypothèse est apparue intéressante
lors d’une discussion avec M. Frédéric Heran, chercheur
en économie des transports à l’IFRESI-CNRS à Lille
(2) : le calcul est fait en détail dans le premier article publié
en 2001 "La vitesse généralisée"
Fédération Nord Nature, 23 rue Gosselet, 59000 LILLE - Tel 03.20.88.49.33 - mail : secretariat@nord-nature.org