 |
Ensemble pour la Nature Nord Nature et l'aménagement du territoire |
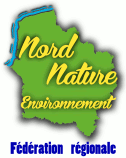
|
La Fédération NORD-NATURE, à l'instar de tous les amoureux de la nature, s'est intéressée très vite à tous les problèmes touchant l'aménagement du territoire, qu'il s'agisse du domaine rural, des infrastructures de circulation, des paysages et, pour ce qui concerne plus particulièrement le Nord Pas-de-Calais, du pays minier, et même de l'aménagement urbain.
NORD-NATURE était intervenue déjà dans l'élaboration par l'O.R.E.A.M. Nord du Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (S.D.A.U.) de la région dès 1970-71 (voir le chapitre "Naissance de NORD-NATURE". La Fédération s'y est intéressée régulièrement par la suite, en particulier à l'occasion des discussions et de l'élaboration des divers contrats de plan ; les dernières propositions "Observations et propositions de NORD-NATURE dans le cadre de l'aménagement du territoire et du Contrat de Plan" ont été publiées récemment dans notre Bulletin (J. Istas, 1999, fasc.96, p.7-19). Elle est ainsi intervenue à la fois par des courriers avec critiques et propositions alternatives, mais aussi directement par des interventions dans les diverses instances où elle était représentée (C.E.S.R., Agence de l'eau, Commissions spécialisées). Tous les aspects qui ont motivé des interventions de NORD-NATURE au sujet de l'aménagement du territoire ne peuvent être rapportés ici. Je ne mentionnerai que les principaux.
1°/ Aménagement rural / remembrement
Dès la mise en œuvre de la loi d'orientation agricole de 1960, qui a déclenché le développement de l'agriculture de type industriel, le paysage rural a subi des bouleversements importants qui se sont apparentés à une véritable dévastation des milieux naturels : remembrements avec création de grandes parcelles, arasement des talus et des haies, élimination des arbres qui constituaient autant d'obstacles à la mécanisation, utilisation d'engins de plus en plus gros, de plus en plus lourds, diminution des amendements organiques et augmentation des intrants chimiques, assèchement des zones humides...
Tout ceci a eu de nombreux impacts sur la nature, ses équilibres et la biodiversité. NORD-NATURE a donc tenté de rétablir un peu de "raisonnable" dans les décisions qui intervenaient.
L'occasion lui a été donnée par la loi sur l'aménagement rural de 1975. En effet, cette loi a instauré des Commissions communales où devaient siéger des P.Q.P.N. (Personnes Qualifiées pour la Protection de la Nature). La loi de 1976 sur la protection de la nature a, pour sa part, instauré l'obligation d'effectuer des études d'impact. C'étaient là les deux outils nécessaires pour pouvoir intervenir. NORD-NATURE a donc été immédiatement d'accord pour les utiliser au mieux. Plusieurs conditions étaient nécessaires :
- trouver des personnes volontaires, bénévoles, compétentes et disponibles pour être P.Q.P.N. ,
- les former aux fonctions de P.Q.P.N.,
- pouvoir s'appuyer sur des études d'impact sérieuses.
Dès 1976, NORD-NATURE s'est organisée pour faire face au problème avec un séminaire organisé à Lille avec :
- J.F. Terrasson du Museum de Paris, spécialiste des haies et du remembrement
- un délégué au Colloque de Rennes sur le remembrement organisé par l'I.N.R.A.,
et surtout :
- une large participation à un stage sur le remembrement organisé en collaboration avec la Délégation Régionale à l'Environnement (directeur : Mr Villey) à Blendecques les 20 et 21 novembre 1976.
C'était le démarrage des actions.
Dès lors, NORD-NATURE proposa des P.Q.P.N. partout où étaient mises en route des procédures d'aménagement foncier. En 1977, 38 communes étaient ainsi pourvues de P.Q.P.N. dans le département du Nord, 72 dans le Pas-de-Calais ; ce service, organisé par A. Delelis, Membre du Conseil d'Administration de NORD-NATURE, a bien fonctionné plusieurs années. Mais divers problèmes se sont fait jour au fur et à mesure :
- d'abord le manque de soutien financier : en effet l'action des P.Q.P.N. et la coordination entraînaient des frais non négligeables pris en charge par la seule association et difficilement supportables sur la durée ;
- ensuite la nécessité de recruter toujours plus de nouveaux P.Q.P.N. et de les former.
En ce qui concerne les finances, les Départements se montrant extrêmement réticents pour l'octroi d'aides aux associations, il a fallu attendre le contrat de plan régional en 1984 pour bénéficier de crédits. Grâce à la subvention octroyée, NORD-NATURE a pu réaliser un numéro spécial "Aménagement rural et protection de la nature" distribué gratuitement à tous les P.Q.P.N., ainsi qu'un petit manuel de conseils pratiques.
Des stages de formation ont été régulièrement organisés par NORD-NATURE depuis 1977, tous les deux ans en moyenne jusqu'en 1999.
Mais le problème des P.Q.P.N. s'est accru avec la loi "Paysage" de 1993 car trois P.Q.P.N. ont été demandés pour chaque C.C.A.F. (Commission Communale d'Aménagement Foncier) dont deux proposés par les associations. A cette demande NORD-NATURE fait toujours face de son mieux ; mais il y a, en permanence, quelque 50 à 100 communes sur la région à pourvoir (en 1999, NORD-NATURE fournissait encore quelque 50 communes en PQ.P.N.) et il est nécessaire de relayer les bonnes volontés, d'autant qu'avec les mesures agrienvironnementales et maintenant les C.T.E.(Contrats territoriaux d'exploitation), la tâche se complique.
D'autre part, malgré les lois récentes sur l'eau (1992) et les paysages (1993) l'aménagement rural ne continue d'être conçu que trop localement. Dès 1987, je proposai au C.E.S.R., au nom de NORD-NATURE, de promouvoir la prise en considération de l'ensemble des bassins versants dans le cadre de syndicats intercommunaux pour prendre en main l'aménagement rural. Ce sont en effet les seules structures qui pourraient avoir une vision globale des problèmes sur un territoire. Mais, en l'an 2000, l'idée n'a pas encore vraiment progressé (voir plus loin le paragraphe "Pays et .S.A.G.E.").
De plus, les problèmes de déprise agricole, de jachères, de quotas laitiers sont venus compliquer les problèmes d'aménagement rural avec des transformations de l'utilisation des espaces agricoles. NORD-NATURE a alors tenté d'apporter des solutions raisonnables et adaptées par des interventions nombreuses en commissions, mais souvent en vain.
Pour suivre l'évolution de la législation et des soucis environnementaux, NORD-NATURE a donc récemment publié deux nouveaux fascicules spéciaux : l'un consacré à la réglementation "Aménagement rural. Procédure et Législation. Guide pour P.Q.P.N." (1998) et "Biodiversité et Aménagement rural" (1998).
Dans ce domaine de l'aménagement rural, NORD-NATURE a fourni, depuis vingt cinq ans, un effort énorme au service de l'intérêt général, puisque en plus des désignations de P.Q.P.N., de très nombreuses conférences et interventions ont été effectuées en divers lieux de la région, des dossiers ont été élaborés pour aider des agriculteurs en difficulté et des associations locales submergées par l'ampleur des problèmes ; un montage audiovisuel a également été élaboré "La haie brise-vent" par Ph. Delattre, membre du Conseil d'Administration, qui traite en fait, des problèmes essentiels liés à l'importance de la sauvegarde des haies.
Mais NORD-NATURE constate toutefois, avec une certaine amertume, que tous ces efforts n'ont pas eu les résultats qu'ils auraient mérités car l'aménagement rural reste encore très imparfait.
Références
- Le remembrement dans la région du Nord, A. Delelis, Bull. NN, 1977, fasc.8, p.4-20
- A propos du remembrement, P. Delattre. Bull. NN, 1978, fasc.10, p.29-30
- Etudes d'impact et remembrement, E. Vivier, Bull. NN, 1978, fasc.13, p.42-43
- Remembrement, diffamation et "Combat-Nature", A. Delelis, Bull. NN, 1979, fasc.14, p.11-13
- Le remembrement, A. Delelis, Bull. NN, 1981, fasc.22, p.28-30
- Redécouvrir les haies dans le Nord Pas-de-Calais. II - Importance économique des haies et brise-vent, A. Delelis, Bull. NN, 1981, fasc.23, p.21-25
- C.R. du stage remembrement des 19 et 20 novembre 1983 à Morbecque le Parc, V. Terry et V. Monflin, Bull. NN, 1984, fasc.35, p.38-44
- Comité économique et social régional. Observations, E. Vivier, Bull. NN, 1987, fasc.46, p.18
- Agriculture et environnement, A. Delelis, Bull. NN, 1988, fasc.51, p.5-9
- Note aux géomètres, A. Delelis, Bull. NN, 1989, fasc.54, p.34
- Aménagement rural et P.Q.P.N., E. Vivier, Bull. NN, 1990, fasc.58, p.12-13
- Remembrement et milieu rural, J. Istas, Bull. NN, 1991, fasc.65, p.35-36
- Mesure agri-environnementales... un bilan bien modeste, E. Vivier, Bull. NN, 1999, fasc.94, p.30-31
- Aménagement rural. Procédure et législation, E. Vivier, Bull. spécial NN, 1998, fasc.91, 36 p.
- P.Q.P.N. : qu'est ce que c'est ? E. Vivier, Bull. NN, 1999, fasc.94, p.32-34
- Biodiversité et aménagement rural, E. Vivier, Bull. spécial NN, 1998, fasc.93, 48 p.
2°/ Les infrastructures : une préoccupation constante
Les infrastructures de circulation (routières, ferrées ou voies d'eau) ont été depuis sa création, une préoccupation permanente de NORD-NATURE qui a motivé de très nombreuses interventions et de non moins nombreuses propositions.
Les choix politiques et/ou économiques ont souvent été faits par les décideurs, qui n'ont presque jamais pris en compte les considérations environnementales... presque jamais, mais ces soucis commencent cependant à apparaître. Nos actions et l'évolution des esprits porteraient-elles leurs premiers fruits ?
Quelques grands aménagements ont mobilisé nos activités à certaines périodes :
- l'A27 (Lille-Valenciennes) : le problème a été évoqué au paragraphe des luttes juridiques. Je n'y reviens pas.
- l'A16 (autoroute du littoral)
- Le projet A1bis ou A24
- Le projet de la Rocade Sud de Lille
- Le tunnel sous la Manche et le T.G.V.
- La liaison Seine-Nord par canal à grand gabarit
Les infrastructures routières
La Fédération NORD-NATURE ne s'est intéressée directement qu'aux grandes infrastructures, laissant aux associations locales fédérées les problèmes des routes traditionnelles, tout en leur apportant, dans la mesure du possible, son aide en conseil et relais.
L'autoroute A16 (Rocade littorale) de la frontière belge vers Calais, Boulogne et Abbeville a été l'objet de notre opposition la plus ferme car nous lui préférions la mise à 2 x 2 voies de la nationale 1, en proposant les contournements d'agglomérations nécessaires. C'était parfaitement possible et largement suffisant ; mais cette solution n'a pas été envisagée par les décideurs. Quant au tracé de l’autoroute, trois fuseaux étaient proposés ; là encore, le moins perturbateur pour la nature et l'environnement était celui qui passait le plus à l'intérieur, le tracé Est, mais c'est le plus dévastateur (et aussi le plus coûteux) qui a été choisi sous la pression des élus du littoral. NORD-NATURE a accompagné d'autres associations (dont le G.D.E.A.M., le Groupement de Montreuil) dans un Recours au Conseil d'Etat ; mais ce recours a été rejeté comme l'avait été celui que nous avions déposé au sujet de l'A27 (voir chapitre "Luttes juridiques"). Des zones humides importantes ont été dégradées (Canche, Authie...), des portions sont dangereuses en cas de vents violents... mais la décision politique a primé sur la raison et il n'est pas sûr qu'elle ait servi l'intérêt économique.
La conscience de la préservation de la nature et de l'environnement dans le cas des grands chantiers, a encore à progresser.
Les autres luttes au sujet des grandes infrastructures en sont encore au stade de la lutte contre des projets. Mais ces projets sont anciens. Le projet A1bis ou A24 qui doit relier Lille et Amiens en traversant le pays minier dans le Béthunois est de ceux-là. NORD-NATURE proteste à triple titre :
- d'abord parce que cette voie ne se justifierait pas si une autre organisation des transports était envisagée en utilisant plus et mieux le fer et la voie d'eau ;
- ensuite parce que le gros du trafic routier de fret (poids lourds) ne suit pas un axe passant à l'Ouest de Lille mais un axe se situant à l'Est, ce qui correspond à un mauvais choix de tracé pour un éventuel doublement de l'A1 ;
- enfin parce qu'il existe des possibilités alternatives en mettant à 2 x 2 voies certaines routes nationales que NORD-NATURE a proposées.
Des manifestations, des interventions nombreuses ont été effectuées depuis 1991 ; le projet recule, paraît parfois abandonné puis revient... La raison a, là encore, des difficultés à s'imposer.
Un autre point important concerne les projets autoroutiers au Sud de Lille.
De tels projets étaient apparus dès le début des années 70 (voir Bull. NN, 1979, fasc.15) et avaient suscité l'opposition des populations et associations de NORD-NATURE ; le projet de Rocade Sud était alors tombé dans l'oubli pendant les années 80. Mais il est revenu plus fort que jamais au milieu des années 90 avec le nouveau "Schéma directeur de Développement et d'Urbanisme" de la C.U.D.L. et nous avons dû à nouveau nous y opposer. Pourquoi notre opposition ?
Pour une raison essentielle : elle met en danger la principale ressource d'eau d'alimentation de l'agglomération lilloise. En effet, cette rocade autoroutière passe sur des champs captants irremplaçables, non protégés géologiquement. Une préservation absolue vis-à-vis de tous les risques possibles est indispensable. Mais là encore, si des Services de l'Etat sont du même avis (D.I.R.E.N., Agence de l'Eau), les décideurs politiques veulent leur rocade. D'où une lutte sérieuse engagée par NORD-NATURE et des interventions vigoureuses (auprès des Instances dans lesquelles siègent NORD-NATURE (Agence de l'Eau, C.E.S.R.) et auprès de divers responsables (C.U.D.L., Conseil général, D.D.E.) ; un Recours a donc été déposé au Tribunal administratif car certaines procédures semblent ne pas avoir été respectées par les services d'urbanisme, en particulier vis-à-vis du S.D.A.G.E. (Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) approuvé dès 1997 (voir le chapitre luttes juridiques).
Tunnel sous la Manche et T.G.V.
Du T.G.V., NORD-NATURE n'a que peu de choses à dire. Nous avons en effet été informés au fur et à mesure de l'évolution du projet, nous avons pu faire des remarques dont certaines ont été prises en compte, en particulier pour le passage au travers de zones humides ou de forêts et la mise en place de meilleures protections contre les nuisances phoniques. C'était une infrastructure de transport que nous jugeons utile et sa réalisation s'est faite au moindre mal.
Par contre, en ce qui concerne le Tunnel sous la Manche, si nous avons bien été sollicités pour participer au groupe de réflexion mis en place par la D.RA.E., si nous avons participé dans ce cadre à de multiples réunions avec le "Chargé des relations publiques" de Transmanche, nous ne pouvons qu'exprimer notre déception, constamment renouvelée devant l'absence de réponse à nos questions et observations. Nous avons lutté pour protéger le site en cours de classement du Fond Pignon (entre le Blanc Nez et Sangatte) contre le dépôt des boues résultant du creusement du tunnel. Nous avons posé de nombreuses questions concernant l'utilité du puits de Sangatte par lequel les boues étaient évacuées alors que la craie aurait pu, selon nous, être évacuée directement par le tunnel à Coquelles.
De plus la décision préfectorale d'autorisation du puits de Sangatte nous était apparue contraire à une loi de 1892, toujours en vigueur. Nous avons donc effectué un Recours au Tribunal Administratif contre l'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire, mais celui-ci a été rejeté. La justice a considéré que ce puits était un "aménagement provisoire évolutif" (!).
Dans toute cette affaire du Tunnel, NORD-NATURE a défendu les valeurs qui font partie de ses objectifs. Mais le Tunnel s'est fait. Le dépôt des déblais sur les flancs des collines du Fond Pignon a donné naissance à un gigantesque lac de boues blanches retenues par un remblai ; ce dépôt liquide qui devait, selon les aménageurs, se dessécher en deux-trois ans pour être végétalisé est toujours un lac dix ans après.
Heureusement le reste du site du Blanc-Nez a fini par être classé et des oiseaux d'eau prennent possession du lac ; mais une gigantesque zone en arrière de Calais a été artificialisée. NORD-NATURE, dans tout cela, n'a pas réussi à faire grand chose malgré beaucoup d'efforts et pourtant, il eût été possible de mieux accorder les aménagements avec la nature.
Rivières et canaux
Les rivières du Nord ont été maltraitées, parfois complètement transformées, depuis les X et XI° siècles jusqu'à nos jours : endiguements, rectifications de cours, canalisation, ... on les a progressivement transformées, pour beaucoup d'entre elles, en simples fossés d'écoulement, et d'écoulement d'eaux usées. La rivière, milieu de vie, a été ignorée. Le souci de NORD-NATURE pour l'aménagement des rivières a donc été, toujours, de tenter de sauver celles qui restaient naturelles en empêchant les aménagements dévastateurs. Des propositions ont été faites (Bull. NN, 1976, fasc.5 ; voir aussi, plus haut, le chapitre "Actions exemplaires") et un numéro spécial a été publié (1987) ; des interventions nombreuses ont eu lieu en opposition à des rectifications, mais souvent en vain.
Plus particulièrement, de très nombreuses propositions ont été faites pour des aménagements destinés à éviter crues et inondations (voir numéros spéciaux sur ce thème, 1987, 1997).
Rétablir les rivières du Nord dans un état sain et équilibré par un aménagement rationnel reste toujours un objectif d'actualité pour les années futures.
Quant aux canaux, c'est le projet de liaison Seine-Nord avec mise au grand gabarit, qui a mobilisé notre attention et nos efforts depuis le début, après les actions menées pour le sauvetage de la Vallée du Haut-Escaut dans les années 70 (voir le chapitre "Escaut vivant").
En effet dès cette époque, un projet de mise au grand gabarit du canal de St Quentin existait, qui passait par Cambrai et risquait d'entraîner le saccage de la vallée du Haut-Escaut ; une association de défense de cette vallée (Président : M. Dufour) s'est alors créée et a adhéré à NORD-NATURE. Nous avons donc participé à la lutte contre ce projet, y compris, là encore, en associant les aspects économiques aux aspects écologiques, voir l'article publié par "l'Information géographique" (E.Vivier) au niveau national (voir biblio) : notre opposition à ce projet des Voies Navigables s'est étalée sur plusieurs années et NORD-NATURE a pu obtenir qu'une étude soit réalisée pour la mise au grand gabarit du Canal du Nord.
C'est au début des années 90 qu'un nouveau projet de liaison fluviale Seine-Nord est apparu (voir Bull. NN, 1993, fasc.33). Bien sûr, NORD-NATURE s'y est tout de suite intéressée pour qu'une solution rationnelle soit recherchée et ne reprenne pas les anciens projets des années 70 ; nous sommes donc intervenus, par tous les moyens possibles : propositions à tous les niveaux, conférences-débats dont l'une dans le cadre d'un colloque interassociatif organisé par nos soins à la M.N.E. le 12 juin 1993, interventions aussi dans les différentes instances officielles où siégeait NORD-NATURE, rendez-vous avec des élus, en particulier les Verts.
Nos demandes d'examen de plusieurs projets ont été entendues. La région Nord Pas-de-Calais, dirigée à l'époque par Madame Marie-Christine Blandin, a lancé une première étude qui se révélait favorable à un tracé Ouest et donc défavorable au tracé par Saint Quentin et Cambrai. Le Ministre a, de son côté, ordonné une étude globale du problème par les Voies Navigables. Un Comité de suivi a été nommé et j'ai été désigné parmi la dizaine de personnalités retenues pour y siéger ; honnêtement, je ne connaissais pas grand’chose aux canaux, ni aux péniches, ni au transport par voie d'eau : j'ai dû apprendre et j'ai fait une première expérience de navigation en péniche à cette occasion.
Les études des différentes possibilités de liaison par canal à grand gabarit Seine-Nord ont été effectuées avec un très grand sérieux, une parfaite objectivité. J'ai pu les suivre et participer à de nombreuses réunions à Paris. Une très large information-participation de la société civile et des associations a été organisée dans une parfaite indépendance.
La très grande innovation de cette étude a été la mise au point et la réalisation d'une étude multicritère qui, pour la première fois depuis que se conçoivent de grands aménagements, était utilisée et prenait en compte l'environnement dans tous ses aspects.
C'était une "première" de taille que toutes les associations de défense de la nature ne peuvent que saluer en espérant que l'exemplarité de cette étude soit reprise pour tous les grands aménagements.
L'évolution du projet peut être suivie par la lecture des articles publiés dans notre bulletin (voir références en fin de paragraphe). J'ai fait partie, en deux fois deux ans, des Comités de suivi ; le rapport final avec toutes ses conclusions a été remis au Préfet coordinateur de Picardie et au Ministre début 1997. Le Ministre des transports devait prendre la décision du choix du tracé avant la fin de l'année pour le lancement des travaux.
En l'an 2000, nous sommes toujours au point mort : rien n'a été décidé, rien n'est fait.
La D.U.P. était prévue pour 1998 et la construction devait démarrer en 1999... mais toujours rien à l'horizon.
NORD-NATURE et beaucoup d’associations fédérées ou partenaires dans cette affaire Seine-Nord, se sont fortement investies en participant régulièrement aux concertations mises en place par V.N.F. (Voies Navigables de France) sous le regard du Comité de suivi, partout dans les régions Picardie et Nord Pas-de-Calais.
Espérons que ce ne sera pas en vain.
Références
Infrastructures routières
- La rocade sud sur le territoire d'Emmerin, Emmerin-Nature, Bull. NN, 1979, fasc.15, p.28-35
- Une nouvelle agression pour notre région : l'Autoroute A1bis, E. Vivier et J. Istas, Bull. NN, 1991, fasc.63, p.3-8
- Autoroutes, ça suffit ! J. Istas, Bull. NN, 1993, fasc.70, p.11-15
- Aménagements routiers : les ambitions irresponsables de la politique métropolitaine, E. Vivier, Bull. NN, 1994, fasc.77, p.7
- Bagarre : eau contre autoroute, E. Vivier, Bull. NN, 1994, fasc.74, p.16
- Lille 2004 et contournement autoroutier Lille-Sud, R. Biermant, Bull. NN, 1997, fasc.86, p.27-31
- Inadmissible ! la protection de l'eau potable des champs captants remise en cause par les décideurs, R. Biermant, Bull. NN, 1997, fasc.88, p.30
- Rocade Sud et champs captants, E. Vivier, Bull. NN, 1998, fasc.92, p.25-30
T.G.V. et Tunnel
- Tunnel sous la Manche (ou pont), c'est reparti ! E. Vivier, Bull. NN, 1985, fasc.41, p.1-2
- Enquête d'utilité publique sur le lien Transmanche. Observations de la Fédération NORD-NATURE, NORD-NATURE, Bull. NN, 1986, fasc.44, p.13-20
- Transmanche, site des Caps et problème de déblais, Amis du Fort d'Ambleteuse, Bull. NN, 1987, fasc.46, p.9-10
- Le Tunnel sous la Manche et la Justice, E. Vivier, Bull. NN, 1987, fasc.40, p.8
- Le Transmanche et la Justice, E. Vivier, Bull. NN, 1988, fasc.50, p.27-28
- L'environnement du tunnel... des questions se posent et les bavures continuent, E. Vivier, Bull. NN, 1988, fasc.51, p.12
- Observations de la Fédération NORD-NATURE sur le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du T.G.V. Nord, E. Vivier, Bull. NN, 1988, fasc.52, p.29-30
- Le tunnel sous la Manche. La position des associations. Le problème global, E. Vivier, Bull. NN, 1989, fasc.56, p.29-30
- NORD-NATURE et le T.G.V. Nord, R. Biermant, Bull. NN, 1991, fasc.62, p.44-46
Canaux et rivières
- Inconvénient du projet de canal à grand gabarit dans le Cambraisis, M. Dufour, Bull. NN, 1977, fasc.8, p.34-39
- Le canal à grand gabarit Seine-Nord... Quel projet ? La rédaction, Bull. NN, 1983, fasc.33, p.38
- La liaison Seine-Nord par canal à grand gabarit. Vue d'ensemble des problèmes, E. Vivier, Bull. NN, 1993, fasc.72, p.11-17
- Liaison Seine-Nord par canal à grand gabarit, E. Colot, Bull. NN, 1994, fasc.74, p.33
- L'écosystème canal et la maladie des canaux, E. Vivier, Bull. NN, 1994, fasc.76, p.11-13
- Le canal Seine-Nord enfin sur la bonne voie, E. Vivier, Bull. NN, 1996, fasc.84, p.15-18
- Réflexions sur l'aménagement d'une rivière, E. Vivier, Bull. NN, 1976, fasc.5, p.45-50
- Eaux et rivières, E. Vivier, Bull. NN, 1987, fasc. spécial 47, 60 p.
- Le gigantisme au moindre mal, J. Istas, Bull. NN, 1997, fasc.88, p.4
- Le canal doit faire sauter les ponts, E. Vivier, Bull. NN, 1997, fasc.88, p.15
- Des nouvelles de l'Escaut, E. Vivier, Bull. NN, 1997, fasc.88, p.5-6
- Inondations et sécheresses, J. Istas, Bull. spécial NN, fasc.89, 1997
3°/ Pays minier
Les exploitations minières, les implantations industrielles, l'intense urbanisation de tout le secteur, ont profondément bouleversé les paysages, créé des désordres graves dans le fonctionnement des phénomènes naturels (en particulier la circulation des eaux) et entraîné de multiples pollutions. Tout cela laisse des séquelles importantes et inquiétantes dont l'aménagement du territoire doit aujourd'hui tenir compte pour tenter d'y remédier.
NORD-NATURE a, dès sa création, dû prendre en considération tous ces problèmes. Parmi les séquelles de l'exploitation minière, il y a les terrils. Territoires de l'activité historique de cette région, ils ont été en partie reconquis par la nature et méritent en leurs qualités de témoins d'un passé laborieux, de sites de reconquête pionnière par des plantes et des animaux, d'éléments de diversité dans le paysage, d'être préservés pour la science, pour la pédagogie, pour le tourisme.
NORD-NATURE est très fréquemment intervenue pour la protection des terrils, mais après son S.O.S. de 1981 (voir réf.) elle a laissé le soin à ses associations de terrain de gérer au mieux les problèmes de conservation (voir article Bull. NN, 1985, fasc.40) et n'est intervenue qu'au coup par coup comme en témoignent les compte-rendus annuels d'activités (voir bulletins).
Il en a été de même pour les effondrements miniers. Toutefois les problèmes étaient tels qu'ils ne pouvaient pas ne pas être pris en considération de manière globale.
C'est la raison pour laquelle j'ai proposé en 1989 un projet global d'aménagement de tout le pays minier, prenant en considération les effondrements et les risques d'inondation ; ces risques sont actuellement réduits par le fonctionnement de pompages permanents de relevage, mais ce système n'est pas durable... on ne peut pomper éternellement, nuit et jour, des milliers de m3. La solution consiste à laisser l'ennoyage progressif s'effectuer dans les zones effondrées qui sont situées au-dessous du niveau piézométrique (niveau normal de la nappe phréatique superficielle.
Cette proposition, qui dérange, a évidemment soulevé maintes protestations. En effet les zones minières, même au niveau des effondrements, sont abondamment urbanisées et les maires délivrent encore sur ces terrains à risques des permis de construire. La mise en eau des zones inondables par arrêt des pompages signifierait l'abandon de nombreuses habitations. Mais il s'agirait, bien évidemment, non d'une solution brutale et immédiate, mais d'un plan d'aménagement concerté, étalé dans le temps sur la durée nécessaire (20... 50 ans... plus peut-être) et zone par zone. Il serait possible de reconstituer une vaste zone d'étangs et de lacs qui, outre l'intérêt paysager nouveau, pourrait générer des activités touristiques et ludiques florissantes.
Ce plan, qui paraissait utopique, a été pris en considération par la "Conférence permanente du Pays minier" mise en place par la région sous la responsabilité de J.F. Caron, Vice-Président du Conseil régional. Contesté, discuté, le plan progresse peu à peu dans les esprits et peut-être, un jour, deviendra-t-il la solution rationnelle et raisonnable.
NORD-NATURE aura permis de faire avancer des idées, de promouvoir des solutions.
Références
Pays minier
- "S.O.S. Terrils". Un cri d'alarme pour la sauvegarde de nos terrils, J. Godin, Bull. NN, 1981, fasc.22, p.25-26
- A la découverte de nouveaux espaces naturels au cœur du bassin minier, R. Trouvilliez, Bull. NN, 1985, fasc.38, p.31-34
- La classification des terrils régionaux, R. Trouvilliez, Bull. NN, 1985, fasc.40, p.12-14
- Dans le pays minier. Eau potable : une situation quasi désespérée, E. Vivier, Bull. NN, 1989, fasc.54, p.33
- Suggestion pour un aménagement écologique du pays minier. Le pays noir transformé en vert et bleu, E. Vivier, Bull. NN, 1989, fasc.57, p.25-30
- L'aménagement du pays minier en question, E. Vivier, Bull. NN, 1990, fasc.59, p.25-26
- Pays minier en question, E. Vivier, Bull. NN, 1996, fasc.83, p.44
4°/ Aménagement des eaux et DU territoire
Les aménagements concernant les eaux ont toujours été faits de manière incohérente en fonction des besoins ou des caprices locaux, sans vision d'ensemble, ni dans l'espace, ni dans le temps. De plus l'eau a toujours été considérée comme une ressource inépuisable et nécessairement gratuite.
Mais il a fallu réviser ces notions ; La création des Agences de Bassin avait été le premier grand pas vers une organisation territoriale et une gestion des eaux. NORD-NATURE a tout de suite vu là l'occasion de coopérer et d'apporter son point de vue. La bataille de la Canche (voir le chapitre consacré à ce problème) a été la première et très vite, NORD-NATURE a posé sa candidature pour participer au Comité de bassin.
La loi sur l'eau de 1992 a visé à perfectionner l'organisation et affiner la gestion par la définition d'un Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) et par la mise en place du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) gérés par une Commission Locale de l'Eau (C.L.E.). NORD-NATURE, par ses responsables et par certaines de ses sociétés affiliées, a participé largement à la définition du S.D.A.G.E.. Quant aux S.A.G.E., j'ai été immédiatement partisan de les limiter aux bassins versants des différentes rivières et c'est ce modèle qui a été choisi.
Les S.A.G.E. se mettent lentement et difficilement en place, mais on s'aperçoit que les C.L.E. n'ont pas de pouvoir : il faut créer des Syndicats intercommunaux recouvrant les territoires définis par les S.A.G.E.
Or, déjà en 1984, j'avais proposé dans un éditorial (Bull. NORD-NATURE fasc.36), ce même remède : des Syndicats de bassin. Donc huit ans avant la loi sur l'eau, quinze ans avant que ne se créent ces syndicats indispensables à la mise en place des S.A.G.E., NORD-NATURE avait proposé la bonne solution... elle était passé inaperçue et il va bien falloir quelques années encore pour qu'elle devienne fonctionnelle.
D'ailleurs on est déjà plus loin. En effet la nouvelle loi sur l'aménagement durable du Territoire, dite loi VOYNET, va créer des "PAYS". Alors je propose encore, au nom de NORD-NATURE, de "faire coller" ces Pays, ou nouveaux territoires, avec les Syndicats de bassin précédents, de faire coller les pays et les S.A.G.E. dans un même ensemble : les PAYS-SAGE (voir bull. NN, 1999, fasc.95).
Mais là encore, cette idée de NORD-NATURE devra sous doute attendre un peu pour que les responsables politiques en prennent conscience. L'eau, facteur indispensable à la vie, élément essentiel de tout développement humain durable, devrait être à la base de tout aménagement du Territoire.
S.D.A.G.E. - S.A.G.E. - PAYS - PAYSAGE.
Espérons que demain, l'utopie d'aujourd'hui sera réalité. NORD-NATURE sème une graine.
Références
Eaux et territoire
- Gestion des sols... gestion des rivières... rien ne va plus ! Un remède des Syndicats de bassin, E. Vivier, Bull. NN, 1984, fasc.36, p.1-2
- Le S.A.G.E. à la base d'une nouvelle entité territoriale, E. Vivier, Bull. NN, 1999, fasc.95, p.34-35
| Vite . . . la suite |
Fédération Nord Nature, 23 rue Gosselet, 59000 LILLE - Tel 03.20.88.49.33 - mail : webmaster@nord-nature.org