 |
Ensemble pour la Nature Les premiers grands combats |
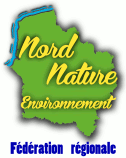 |
1°/ La bataille de la Canche
Le projet de barrage en Baie de Canche avait vu le jour à la fin des années 60. Il faisait suite à un projet de pompage des eaux de la Vallée de la Canche au niveau d'Hesdin (soit 40 km en amont du Touquet) en vue d'alimenter l'agglomération lilloise qui risquait de manquer d'eau.
Dans l'esprit de nos responsables politiques de l'époque et tout particulièrement des conseillers généraux, cette action était vécue comme la fourniture d'eau du Pas-de-Calais au Département du Nord. D'où l’idée d’une demande de "compensation" qui avait germé dans l'esprit du Maire du Touquet : un barrage de la baie de Canche qui serait pris en charge par les deux départements. Une Commission interdépartementale avec, à sa tête, le Maire de Saint-Martin les Boulogne, avait donc été créée pour mettre au point l'ensemble des projets : le pompage des eaux de la Canche pour Lille, le barrage du Touquet et, bien sûr, la couverture financière du tout.
Fin 1970, le projet était au point, techniquement, administrativement et financièrement : les Assemblées départementales et régionale avaient donné leur accord et promis les crédits, l'Agence de l'eau aussi ; quant aux Ministres concernés ils avaient eux-aussi donné leur accord.
C'était donc, selon la terminologie consacrée, "un coup parti".
C'est alors que la Fédération NORD-NATURE s'est créée et est intervenue. Bien sûr, des scientifiques, essentiellement botanistes, avaient émis des protestations contre la destruction du milieu estuarien d'eaux saumâtres avec sa végétation spécifique ; les zoologistes s'étaient aussi émus de la suppression de la faune intertidale, elle aussi spécifique de ces milieux ; les ornithologues et... les chasseurs, pour des motivations différentes, protestaient aussi contre la suppression de l'estuaire, milieu de passage des oiseaux migrateurs.
Mais toutes ces protestations n'atteignaient pas les oreilles des décideurs. Il fallait faire plus et mieux.
Tous les opposants, regroupés au sein de la Fédération NORD-NATURE dès décembre 1970, ont engagé la lutte quoique la bataille semblât perdue d'avance.
Essentiellement animée par les scientifiques universitaires qui avaient pris la tête de NORD-NATURE, la lutte a été menée sur plusieurs plans :
- Information auprès de l'opinion publique et des populations locales, en particulier auprès des pêcheurs et de leurs organisations professionnelles.
- Organisation de réunions-débats avec les Administrations et les Services officiels, les promoteurs du barrage, les opposants ...et le public.
- Lancement d'études approfondies pour mieux définir et démontrer le rôle irremplaçable de l'estuaire sur les plans pédagogique, scientifique et économique.
- Protestations, contestations auprès des pouvoirs publics à tous les niveaux : élus locaux, préfets, ministres.
Tout a été mené de front, mais l'opposition n'a pas démarré de zéro. Des botanistes lillois (Professeur Géhu) et amiénois (Professeur Wattez) avaient déjà, depuis 1963, abondamment travaillé sur la flore de l'estuaire ; des botanistes étrangers étaient venus observer cet estuaire qui présentait une zonation exemplaire ; des zoologistes de l'Institut de Biologie maritime de Wimereux avaient inventorié la faune (Professeur Defretin) et, enfin, le bureau MAR (organisation scientifique internationale pour l'étude des MARécages) dans un rapport de 1967, avait retenu l'estuaire de la Canche parmi ceux qu'il fallait absolument sauvegarder ; enfin cet estuaire avait été inscrit par les experts scientifiques régionaux sur la liste des espaces naturels à protéger, liste établie à la fin des années 60 dans le cadre d'un inventaire national.
Dans une réunion du bureau de NORD-NATURE, le 11 février 1971, a été décidée la rédaction d'un "Mémoire sur la Canche", l'élaboration de ce rapport a été effectuée par un groupe de spécialistes (voir encadré 1) ; rédigé en juin 1971, il a été envoyé au Ministre puis diffusé à toutes les autorités concernées, auprès des médias et du public, par des conférences et des expositions.
MÉMOIRE SUR LA CANCHE La préparation de ce rapport a été organisée selon le plan suivant : - Recommandations générales M. Guillon - Rapports antérieurs sur la Canche Professeur Vivier - Etudes scientifiques - Publications Professeur Géhu - Cartes des migrations d'oiseaux M. Guillon - Arguments économiques Professeur Géhu et ProfesseurVivier - Projets d'études et travaux en cours Professeur Géhu, Linder, Vivier et Jean En réalité, le Conseil scientifique de NORD-NATURE a travaillé avec beaucoup d'autres collaborateurs parmi lesquels il faut citer les noms de Somme (géographe), Bonte (géologue), Kérautret (ornithologue), Goulliard, Richard (zoologistes), Madame Dubois (botaniste)... Le rapport définitif présenté par le Professeur Durchon, Président de NORD-NATURE, a été rédigé par J.M. Géhu, M. Guillon et P. Tombal. Il comprenait, outre l'introduction, trois grands chapitres : - les erreurs de conception et d'option d'ordre écologique et scientifique ; d'ordre économique et financier. - les préjudices : scientifiques, pédagogiques, écologiques, économiques, cynégétiques. - la conclusion : mise en garde, proposition. Ce dossier était accompagné d'annexes : bibliographie, publications scientifiques (biologie, écologie, cytogénétique), cautions scientifiques émanant de divers organismes, schémas et photographies, pétitions (comprenant 203.000 signatures : adhérents de NORD-NATURE, Sociétés de chasse, divers). |
Ce mémoire sur la Canche a été suivi par un rapport du Professeur Defretin, Président de l'Université des Sciences et Techniques de Lille et Directeur de l'Institut de Biologie maritime de Wimereux, en septembre 1971 ; ce rapport constituait une critique sévère du projet et annonçait clairement les risques pour la productivité marine.
Ces deux mémoires, de la Fédération NORD-NATURE et du Président de l'Université se sont placés entre deux grands débats contradictoires organisés par NORD-NATURE et l'Association locale de défense qui se mettait en place (animée par Monsieur G. Fachon) et ont permis de pouvoir présenter une argumentation sérieuse à l'occasion du second.
L'un était un débat public avec les responsables politiques, administratifs, associatifs et scientifiques, professionnels (de la pêche surtout), qui a eu lieu au théâtre de Montreuil le 25 janvier 1971. Devant une salle comble (plus de 600 personnes) les différentes parties se sont exprimées en une sorte de dialogue de sourds, mais... et c'est sans doute le plus important, les pêcheurs d'Etaples ont commencé à prendre conscience de l'enjeu. C'est aussi ce jour-là que s'est créé officiellement le G.D.E.A.M. (Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil).
L'autre débat a eu lieu en Mairie d'Etaples le 20 novembre 1971, restreint aux divers responsables concernés (Préfet, Maires d'Etaples et du Touquet avec leurs adjoints ou conseillers, associatifs et scientifiques, organisations professionnelles de la pêche).
Il a donné lieu à des accrochages sévères des deux camps opposés, mais... sur la suggestion des scientifiques de NORD-NATURE et là encore, avec l'approbation des pêcheurs, une condition préalable à la décision finale s'est fait jour : réaliser une étude de la productivité en Baie de Canche pour connaître l’impact éventuel du projet sur la population de crevettes et de poissons.
Quelques jours plus tard, le Syndicat C.F.D.T. des marins-pêcheurs d'Etaples, en collaboration avec les organisations professionnelles maritimes étaploises, dépose un dossier réclamant la réalisation par l'I.S.T.P.M. de l'étude de productivité, envisagée à la Mairie d'Etaples : cette demande sera prise en considération par l'Institution interdépartementale et les crédits nécessaires seront dégagés.
C'était une première victoire... et du temps gagné avant la décision finale.
Une étude de la productivité primaire (productivité végétale) était en cours sous la responsabilité du Professeur Linder, l'étude sur la productivité secondaire (production animale) devait donc lui succéder. Réalisée dans le cadre des travaux de l'I.S.T.P.M. (Institut scientifique et technique des pêches maritimes) par un chargé de missions basé à Wimereux, la direction en a été assurée par le Professeur Durchon (assisté du Professeur Vivier).
Les détails et résultats de ces travaux ont été rapportés dans un article publié dans un bulletin NORD-NATURE (fasc.n° 4, 1975, p.22-37 par E.Vivier). Nous y renvoyons donc le lecteur.
Ensuite ?
Après cette année 1971 qui avait vu la mise en route de tous les moyens utilisables par les fronts associatifs-scientifiques, la guerre d'usure a continué : conférences sur le littoral (de Berck à Dunkerque) et à Lille, à tous les publics (y compris Rotary Club, Lion's Club, enseignants, ingénieurs...), communiqués dans les médias (presse, radio, télévision, interviews...) par les responsables scientifiques de NORD-NATURE.
Les études scientifiques décidées ont été menées : le rapport sur la productivité primaire a été remis en 1973, celui sur la productivité secondaire, terminé en 1974, a été remis à l'I.S.T.P.M. en 1975 ; mais ce rapport, qui confirmait, de manière claire, nos arguments, était curieusement gardé par l'I.S.T.P.M. ; transmis par cet organisme à la Commission interdépartementale, maître d'ouvrage du barrage, il restait non diffusé au public.
C'est alors NORD-NATURE qui l'a rendu public en 1975 par l'intermédiaire de son bulletin.: le virage était abordé.
Une série télévisée "La nature défigurée" animée par Louis Bériot, sur Antenne 2, avait été programmée ; des séquences avaient été tournées, dont une où je montrais la vie sous la prairie à Obione dans l'estuaire ; mais la série, mal ressentie par beaucoup de décideurs, a été interrompue juste avant la diffusion des problèmes de la Canche : l'émission n'a pas été diffusée. |
Ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que les études ont démontré que la productivité biologique de cet estuaire était considérable, même si elle n'était pas visible : elle était de 2000 tonnes par an d'animaux marins dont plus de 1000 tonnes de poissons juvéniles et, pratiquement la totalité des crevettes de tous les bateaux crevettiers d'Etaples ; la productivité biologique invisible était la source de la productivité économique et constituait le revenu de plus de 3000 habitants (pêcheurs et professions annexes). D'où son importance majeure et la nécessité de sa prise en considération.
Un rendez-vous était pris entre le Président de NORD-NATURE (E.Vivier) et le nouveau Directeur de l'Agence de l'Eau (J.Vernier) : le rôle désastreux du barrage était démontré. Quelque temps plus tard, l'Agence de l'Eau annonçait qu'elle cessait son soutien au projet du barrage.
C'est ensuite Pierre Mauroy, Président du Conseil Régional, qui annonçait à son tour, que la Région se retirait aussi et, en même temps, il annonçait la dissolution de la Commission interdépartementale.
C'en était fini du projet de barrage qui avait pourtant, ainsi que le transfert d'eau de la Canche vers Lille, été soumis entre temps à l'enquête publique.
Ce qu'on n'a pas dit, mais a qui a sans doute été aussi d'un poids décisif, c'est qu'entre 1970 (date à laquelle le projet était décidé et financé) et 1976, les coûts avaient doublé et donc qu'il n'y avait plus assez de crédits pour construire le barrage, et personne pour financer le surplus.
Il avait fallu six ans de lutte associative, précédés de trois ou quatre ans d'interventions scientifiques, soit près de dix ans pour réussir à contrer un projet mégalomane et néfaste, pour que le bon sens triomphe, pour que la pêche étaploise soit sauvée, pour que l'estuaire subsiste. Car...il faut le dire, ce projet de barrage était soutenu et présenté par un "expert" en sédimentation marine venu de Nice, qui avait prétendu que sans le barrage, l'estuaire serait obstrué par les vases et les sables en dix ans : nous sommes en l'an 2000, donc trente ans plus tard et, sans le barrage, l'estuaire fonctionne toujours.
Cette première bataille avait vu la conjonction des compétences et de la motivation, de l'opiniâtreté et de la concertation. C'était aussi un succès de la patience et de l'espoir permanent. C'était enfin la victoire du désintéressement au service de l'intérêt général contre l'intérêt privé et local.
Références
- Le futur barrage du Touquet. Rappel géographique et biologique sur les estuaires de la côte boulonnaise, J. Méreau, Bull. Amis Fort d'Ambleteuse, 1971, n° 12, p.3-52
- Le barrage du Touquet, J. Méreau, Bull. Amis Fort d'Ambleteuse, 1973, n°17, p.13-42
- Les formations végétales en Baie de Canche. Productivité primaire et phytogéochimie. J.Duval. Thèse de spécialité, U.S.T.L., 1973, n° 388
- La productivité biologique des estuaires, F.Vignon, Picardie-information, 1973, n°11, p.15-24
- Etude critique du rapport "Projet d'aménagement de la Canche" déposé par Monsieur JP. Mangin devant le Syndicat intercommunal de la Baie de la Canche, J.Méreau, Bull. Amis Fort d'Ambleteuse, 1974, n°20, p.1-32 et 1974, n°21, p.1-64
- Etude de l'écologie et de la productivité de l'estuaire de la Canche, Y. Dessaussoy, I.S.T.P.M. Rapport préliminaire, 1973, I.S.T.P.M, Rapport final, 1974
- Productivité marine et écologie. Aspect à l'échelle mondiale et locale, (pêche, pollution, aménagements), E.Vivier, Bull. NN, 1974, n°2, p.11-23
- L'eau potable et la Canche. Arguments pour, arguments contre : le point de la question, St. Deblock, Bull. NN, 1974, n°2, p.24-25
- A propos des prélèvements d'eau dans la vallée de la Canche, A.Bonte, Bull.NN, 1974, n°2, p.26-30
- Le rôle biologique et la productivité de l'estuaire de la Canche, E. Vivier, Bull. NN, 1975, fasc.4, p.22-37
- Une pièce à verser au dossier du Barrage de la Canche... ou les lois de la nature et des promoteurs, Anonyme. Bull. NN, 1977, n°6, p.24-31
Voir aussi :
les "Bulletins du Groupement des naturalistes Fabre :n° 90, 91,92, 1970, n° 99, 100, 1971, Edition Groupement des Naturalistes Fabre, Lille
2°/ Le sauvetage des dunes
Le littoral du Nord Pas-de-Calais est exceptionnellement riche en dunes. Ces dunes avaient été depuis longtemps répertoriées et étudiées par les naturalistes, les scientifiques et, tout simplement par les amateurs de nature. La découverte des dunes de Wimereux-Ambleteuse (qui existent encore grâce aux Associations) et de celles de Calais à Dunkerque (qui n'existent presque plus malgré les Associations) avait été pour moi, arrivant de mon Auvergne natale, un véritable émerveillement.
Mise à part la dune Marchand, à l'est de Dunkerque, qui était déjà en cours de classement Réserve naturelle (mais déjà aussi en assez triste état) avant 1970, toutes les dunes littorales, de la frontière belge à la Picardie, ont été tour à tour menacées : certaines ont pu être sauvées, d'autres ont disparu. Ce sont quelques épisodes de la lutte pour leur sauvegarde par NORD-NATURE et ses associations affiliées qui vont être ici résumés.
La typologie des dunes régionales, leur zonation, leurs caractéristiques pédologiques, floristiques et faunistiques ont été maintes fois rapportées, par divers articles de nos publications (voir biblio). C'est de la lutte des associations, pour leur existence et leur survie, qu’il va maintenant être question.
Les premières escarmouches
Les alertes au sujet des risques de destruction des dunes surviennent, dès 1970, un peu partout. Certaines concernent des menaces lourdes, d'autres apparaissent plus légères. Entre Dunkerque et Calais, c'est le gigantesque projet d'aménagement industrialo-portuaire qui menace ; démarré dès les années 60, ce projet est rapporté dans le "Livre Blanc" de l'O.R.E.A.M. Nord et va être repris par le S.D.A.U. (1972).
Il y avait, pour les amoureux de la nature, de quoi être affolé : toutes les dunes et zones arrière-dunaires disparaissaient pour laisser la place aux usines (voir schéma). Évidemment NORD-NATURE a protesté par tous les moyens possibles dont des observations qui ont été rapportées dans le Livre Blanc de l'O.R.E.A.M., et par des réponses négatives dans les enquêtes publiques de l'époque.
Mais rien n'y a fait. L'enjeu économique a été plus fort que tout. Les aciéries, la chimie, le nucléaire, les raffineries... et le port autonome ont consommé toutes les dunes entre Dunkerque et Gravelines. J'ai observé, avec désespoir, périodiquement, l'arasement des dunes, le nivellement des sols et la poussée des usines et des lotissements, l'apparition des fumées, des pollutions, des odeurs... la ruine de ce qui fut une zone de nature exceptionnelle.
Heureusement, l'expansionnisme industriel et portuaire a été interrompu entre Calais et Gravelines. Les dunes d'Oye-Plage, celles du Fort vert ont subsisté...; mais le Fort vert a failli être recouvert d'un champ d'épandage de résidus industriels toxiques ; sur l'intervention du Dr Méreau (A.F.A. et Vice-Président de NN), le Maire s'y est opposé... aujourd'hui la zone est protégée par un arrêté de biotope
A l'autre extrémité de la région, au sud du littoral, entre Berck et le Touquet, des dunes magnifiques existaient aussi. Le Ministère de l'Agriculture s'était rendu acquéreur par expropriation d'une grande partie du massif entre Berck et Merlimont ; la gestion en avait été confiée à l'O.N.F., gestion que NORD-NATURE a dû contester. C'était au début des années 70.
En effet, l'O.N.F., dans un esprit de rentabilité, s'était lancée dans un aménagement catastrophique avec drainage des zones humides et plantation de pins maritimes : NORD-NATURE et les botanistes ont bien entendu protesté contre cet aménagement non écologique qui représentait la fin de la vie dunaire. Là encore échanges de courriers, articles et même séquence d'un film tourné par M. Guillon et diffusé par NORD-NATURE. (Littoral dévasté : voir biblio).
Mais, là, c'est la nature qui a eu le dernier mot : les conifères ont péri et seuls, les tuteurs de troènes ont repris goût à la vie. Les dunes ont été sauvées d'elles-mêmes. Plus tard certains massifs ont pu faire l'objet de mesures de sauvegarde (Mont St Frieux).
La victoire de la Slack
Les dunes entre Wimereux et Ambleteuse dites dunes de la Slack, étaient splendides. Mais, en 1970, elles étaient devenues propriété d'une vaste entreprise de carrières "Magnésie et Dolomies de France" (filiale de Jeumont-Schneider du Baron Empain) qui exploitait le sable et escomptait vendre ensuite les terrains aplanis à un promoteur (qui était d'ailleurs trouvé).
Il était grand temps d'intervenir... L'état inquiétant du massif dunaire a été remarquablement décrit dans un article du Bulletin des A.F.A., n° 10 de 1971, auquel nous renvoyons le lecteur. C'est l'Association des "Amis du Fort d'Ambleteuse" qui s'est lancée dans l'aventure, avec le soutien de NORD-NATURE. C'était la lutte de la dernière chance.
Cette association, les A.F.A., occupait en effet une place privilégiée, sur la plage d'Ambleteuse, à l'embouchure de la Slack ; outre la visite du Fort, le Docteur et Madame Méreau organisaient des animations sur la plage, ce qui garantissait une audience auprès du public tous les étés. Des pétitions, demandant le classement des dunes, déjà inscrites depuis 1970 à l'inventaire des sites naturels (ce qui n'apportait aucune garantie légale de sauvegarde), ont été présentées au public : un premier lot important de signatures (2500) a pu être envoyé au Préfet.
L'exploitation du sable continuant, la campagne de pétitions a continué l'année suivante pour demander le classement des dunes. Bien sûr, elle était accompagnée d'une large information par tous les moyens en usage dans nos associations (expositions, conférences...) et par des courriers aux divers responsables. Bien sûr, elle rencontrait l'opposition des exploitants de sable qui avaient déjà creusé des trous énormes dans les dunes en cours de déstabilisation. Une enquête publique pour le classement fut donc ouverte et les A.F.A. purent fournir 2000 signatures favorables au classement en août 1971, NORD-NATURE envoyant de son côté, son avis favorable et un lot de signatures. Là encore tous les moyens médiatiques furent utilisés dans la polémique et une émission télévisée controversée fut diffusée au niveau national sur le problème, montrant l'opposition économie/écologie, où les A.F.A. apparaissaient comme les empêcheurs de "bétonner en rond" puisque bloquant l'extraction du sable ; ils s'opposaient au promoteur belge qui voulait construire villas, bungalows et même, un port de plaisance ; mais une saine réaction locale et régionale permit de rétablir la réalité des problèmes.
Le projet de classement évoluait favorablement et la pression maintenue des associations a alors permis la suite favorable des procédures administratives. Le décret de classement des dunes de la Slack a été prononcé par le Conseil d'Etat, signé par le Ministre Pierre Messmer le 23 novembre 1973 et il est paru au J.O. du 2 décembre 1973 ; en même temps étaient classés la baie de la Slack et le domaine maritime s’étendant devant la baie ainsi que le massif dunaire.
Les dunes étaient sauvées. En principe, le classement devait bloquer l'extraction du sable et mettre fin à l'activité de l'entreprise et aux ambitions des promoteurs. Cependant l'exploitation, quoique ralentie, continuait.
Tous les problèmes n'étaient donc pas terminés et il restait la mise en place d'une gestion sérieuse.
Le Docteur Méreau, Président des A.F.A. et Vice-Président de NORD-NATURE, présentait alors un projet de création d'une Réserve naturelle (Bull.AFA n° 16, 1973). Ce plan était remarquable : il sauvait les dunes, permettait la restauration naturelle de la Baie de Slack en rétablissant la rivière Slack dans son ancien lit, modifié par des travaux sous Napoléon (1803-1805). C'était une occasion unique de rendre à la zone son équilibre écologique et hydrologique.
Mais personne n'a écouté. Il est vrai qu'il fallait d'abord avoir la maîtrise foncière car M.D.F. continuait l'enlèvement de sable qui s'est poursuivi jusqu'en 1977. Heureusement le Conservatoire du Littoral s'est porté acquéreur et le massif dunaire a été acheté en 1978 après des négociations difficiles (M.D.F. exigeait, pour la vente au Conservatoire, le prix du tonnage de sable qu'ils auraient pu extraire si les dunes n'avaient pas été classées). La gestion des dunes a d'abord été confiée à l'O.N.F. mais cet organisme qui n'avait, semble-t-il, aucune connaissance d'un tel milieu, n'a pu arrêter l'érosion éolienne qui sévissait. La gestion est alors passée à Espace Naturel Régional qui a connu aussi beaucoup de déboires ; sa politique d'ouverture au public s'est révélée catastrophique : l'érosion était pire qu'avant et le sable non seulement menaçait la route Wimereux-Ambleteuse, mais aussi risquait d'obstruer l'estuaire et le cours de la Slack. Bien entendu, les associations (A.F.A. et NORD-NATURE) ont protesté vigoureusement de nombreuses fois ; finalement une autre politique de gestion plus respectueuse de la sauvegarde, avec fermeture au public, a été décidée. Les dunes avaient beaucoup souffert mais elles ont pu être sauvées pour l'essentiel.
Mais sans l'action des Association, il n'y aurait plus rien, que des maisons alignées sur un front de mer banalisé, privatisé, perdu... ce qu'il faut aussi souligner, c'est que les pétitions, seules, n'auraient sans doute pas été très efficaces s'il n'y avait eu derrière une information historique, géographique, géologique, biologique, avec des rapports et, aussi, une exposition permanente du Fort d'Ambleteuse, vitrine exceptionnelle de diffusion de l'information... Et encore, la conjonction de l'action locale (par les A.F.A.) et de l'action régionale (par la Fédération) pour le relais vers les niveaux supérieurs de décision.
Références
- Chronique de la Slack, par J.Méreau, Bull. A.F.A., 1971, n°10
- Les Dunes de la Slack, Bull. A.F.A., 1972, n°12
- Chronique de la Slack, par J. Méreau, Bull. A.F.A., 1972, n°13
- Projet de création d'une réserve naturelle dans les dunes de la Slack, par J. Méreau, Bull. A.F.A., 1973, n°16
- Décret portant classement. L'inscription des dunes de la Slack parmi les sites classés, par J.Méreau, Bull. A.F.A., 1974, n°18
- Les dunes du littoral de la Flandre maritime française, par P. Deswarte et Ch.Poinsat. Bull.NN, 1975, fasc.3, p.18-29
- Calais-Dunkerque, un littoral sacrifié, par J.C. Bruneel, Bull. NN, 1976, fasc.5, p.21-29
- Site classé des dunes de la Slack, Ambleteuse-Wimereux par, J.Méreau, Bull.A.F.A., 1977, n°28
- Site classé des dunes de la Slack. Propositions de restauration et d'ouverture au public de la partie ouest du massif dunaire, J. Méreau, Bull. A.F.A., 1977, n° 28, p.23-37 et Bull. NN, 1979, n°16, p.12-19
- Notre patrimoine naturel régional, Spécial photo, Bull. NN, n° 24, 1981
- Les dunes du littoral de la Flandre maritime française, par P.DESWARTE et Ch.POINSAT, Bull. NN, 1975, fasc.3, p.18-29
L'épreuve de l'Enduro des sables
L'utilisation du mot "épreuve" dans ce titre n'est pas le fait du hasard. En effet ce mot est utilisé par les motards et les médias pour caractériser cette course mais pour nous, protecteurs de la nature, l'enduro est aussi une épreuve difficile à supporter car destructrice des milieux naturels dunaires.
Imaginée par le Maire du Touquet, Léonce Desprez, avec l'organisateur Thierry Sabine, cette course de motos dans les sables des dunes au sud de la ville a été lancée pour la première fois en février 1975.
Les chiffres du "succès" de cette manifestation sont impressionnants : 1975 : 300 motos, 1976 : 500 motos, 1977 : 850 motos, etc... A cela il faut ajouter le piétinement de 20.000 à 40.000 spectateurs, parfois plus, qui déstabilise la surface fragile du sable, crée des couloirs d'érosion éolienne, élimine la précieuse végétation dunaire, spécifique et indispensable.
Les protestations des scientifiques pleuvent dans les préfectures et au ministère. La Fédération NORD-NATURE réagit par tous les moyens classiques. A la suite de nos premières protestations, le Préfet avait pris un arrêté interdisant la circulation des véhicules à moteur dans les dunes... car les entraînements des motards s'effectuaient sur toutes les dunes du littoral et toute l'année ; mais, bien évidemment, le Préfet délivrait tous les ans une dérogation pour l'épreuve de l'Enduro. Alors, malgré l'interdiction et en vue de l'épreuve, la pratique de la moto "verte" s'exerçait partout et ses traces pouvaient être relevées à Berck, Comines, Merlimont, Ambleteuse, et même sur les dunes de la Mer du Nord.
De plus, l'attrait des retombées commerciales intéressant les Communes de Cucq et Merlimont, le tracé de l'Enduro s'allongeait au Sud.
Devant le laxisme des autorités la Fédération NORD-NATURE, ne pouvant rester indifférente à la situation de dégradation irréversible des dunes, accentuait ses protestations. Mais il n'était plus temps de demander l'interdiction de la manifestation devant son succès international, il fallait demander sa limitation sur un circuit permanent, limité, étudié de concert entre les autorités administratives et les associations ; ces demandes ont été faites auprès du Préfet et du ministère dès 1978... mais sans suite.
Si l'Enduro était un succès populaire, les habitants même du Touquet protestaient contre ses excès et les nuisances occasionnées ; une association de défense s'était d'ailleurs constituée.
Alors, que faire ?
Il n'y avait aucun moyen juridique utilisable. Sans doute une loi de protection de la nature avait vu le jour en 1976 et un décret d'application de l'article 2 était paru en 1977. Mais la loi n'était pas rétroactive et l'Enduro datait de 1975.
La Délégation régionale à l'Environnement, saisie par nos soins, ne pouvait rien. Mais nos plaintes, auprès de la Fédération française des sociétés de protection de la nature avait eu, au moins, un écho : la F.F.S.P.N. avait délivré, au Maire du Touquet, sur mon intervention à l'Assemblée Générale, le prix marquant son blâme : le prix chardon. Cela n'a pas été seulement symbolique, car l'information locale diffusée, avait coûté à Léonce Desprez son siège de Député aux élections suivantes.
En 1978, c'étaient 1000 motos qui participaient à l'épreuve.
La mesure était comble. NORD-NATURE, en 1979, a, en plus des démarches habituelles, élaboré pour le Ministère un dossier comportant : une documentation scientifique avec un résumé des conséquences d'une telle pratique sur un milieu fragile et une documentation photographique réalisée par le Docteur Méreau et M. Guillon (qui venait en 1978 de sortir son film : "Littoral dévasté" relatant, entre autres, l'Enduro). Ce dossier a eu, enfin un écho : la demande du Ministère au Professeur Géhu (en sa qualité de Directeur du Centre de Phytosociologie de Bailleul) de fournir une "Etude d'Impact". Un résumé de cette étude effectuée par l'Institut d'Ecologie de Metz et remise en octobre 1980, est présenté dans notre Bulletin (1982, fasc.26) : pour l'essentiel, retenons que la surface des dunes où la végétation est totalement détruite est de 25 ha, celle où la végétation est très sérieusement altérée est de 60 ha, c'est donc 85 ha de dunes qui étaient massacrés en 1980.
C'est à cette époque que le Ministre de l'Équipement et de l'Environnement (M. d'Ornano) a innové en créant des déjeuners au Ministère avec des Présidents d'Associations régionales ; j'ai donc pu participer quelquefois à ceux-ci et comme les discussions étaient libres (sans ordre du jour) j'ai saisi l'occasion pour aborder le problème de l'Enduro. J'ai exposé les dégâts et fait part directement de nos propositions : arrêt des dérogations, donc annulation de l'Enduro (sauf à le limiter sur la plage plus ou moins aménagée) et en tous cas limitation à un parcours fixe, épargnant les dunes.
Le Ministère m'a assuré de sa détermination à arrêter la dégradation des dunes et peut-être même l'Enduro. Par courrier, en date du 19 janvier 1981, le Préfet nous promettait de ne pas donner de suite favorable à une demande de dérogation de l'interdiction de circuler dans les dunes... mais...
Mais l'Enduro 81 eut lieu... les promesses visaient seulement 1982, par suite de la nécessité de prévenir assez longtemps avant...
En mai 1981, le Gouvernement change. NORD-NATURE intervient de nouveau auprès du Ministre M. Crépeau, ainsi que du nouveau Préfet dit "Commissaire de la République", et auprès du Président du Conservatoire du Littoral (G. Lengagne) lequel venait d'acheter une bande dunaire au sud du Touquet. Les tergiversations devaient durer encore plus d'un an. D'autant qu'en 1982, profitant de la "vacance" des pouvoirs, l'Enduro était allongé de 24 km et allait au-delà de Cucq, jusqu'aux dunes de Merlimont. C'était la dévastation assurée de tout le milieu naturel. Nos réactions ne pouvaient que s'amplifier.
C'est seulement le 23 novembre 1982 que le Commissaire de la République du Pas-de-Calais et le Sous-Préfet de Montreuil adressent à NORD-NATURE le relevé d'une décision du 19 novembre 1982 fixant enfin, définitivement, les conditions du déroulement de l'Enduro (voir Bull. NN, 1982, fasc.28).
Le tracé de l'Enduro était définitivement fixé. Notre "victoire", partielle, avait demandé sept ans d'efforts, sept ans d'épreuves. Mais jamais rien n'est définitivement gagné : l'Enduro 1984 a vu le rassemblement de 1.100 motos et de 300.000 spectateurs avec, sur le plan économique, un milliard de chiffre d'affaire ; la piste a dû être élargie de 3 mètres au bulldozer. Quant à la dune, propriété du Conservatoire, qui n'avait que 100 m de large, cernée par la piste de l'Enduro, rongée à la fois par l'érosion marine et par l'érosion éolienne, elle n'en a plus que 50.
L'Enduro a aujourd'hui 25 ans ; c'est toujours la même piste. Quant aux dunes, réparées tous les ans au bulldozer et replantées régulièrement d'oyats, combien de temps tiendront-elles ? Dans quel état ?
L'épreuve de l'Enduro, a été, décidément, une dure épreuve.
Références
- C.R. activités de NORD-NATURE 1975, M. Guillon, Bull. NN, 1976, fasc.5, p.18-19
- C.R. activités de NORD-NATURE 1976, Bull. NN, 1977, fasc.7, p.38-39
- Les effets de l'"Enduro des sables" sur les dunes du Touquet à Merlimont, Institut Européen d'Ecologie, Metz, oct.1980, 23 p.
- Les effets de l'Enduro des sables sur les dunes du Touquet à Merlimont. Le milieu dunaire, extraits de l'étude d'impact, Bull. NN; 1982, fasc.26, p.12-18
- L'Enduro des sables fait des petits : NORD-NATURE s'inquiète, Bull. NN, 1982, fasc.28, p.14-16
- Encore plus loin que l'Enduro, plus loin que l'amertume. Éditorial, E.Vivier, Bull.NN., 1984, fasc.34, p.2-5
- L'Enduro des dunes. Amis du Fort d'Ambleteuse et Fédération NORD-NATURE, Feuillet d'information A.F.A., n°15, 1984.
3°/ La lutte contre le nucléaire
Certains pourraient se demander si cette lutte contre le nucléaire est bien une lutte pour la défense de la nature et de l'environnement. Si l'on pouvait en douter en 1970, aujourd'hui les faits le démontrent amplement. Mais ce chapitre devrait également le montrer clairement.
Le développement de l'énergie nucléaire était privilégié ardemment depuis quelques années, en particulier à la suite de la crise pétrolière de 1972, depuis les décisions du Président Pompidou et du Ministre Messmer. L'éventualité d'une forte implantation dans le Nord Pas-de-Calais, est devenue présente à partir de 1974, et trois sites étaient envisagés : Gravelines, le Gris-Nez et Dannes.
Si le projet de Dannes n'a jamais été sérieusement envisagé, les deux autres, par contre, ont généré beaucoup de soucis chez les Associations.
A ces mesures nucléaires, s'en est ajoutée une autre : un projet d'usine d'enrichissement d'uranium à Calais.
Dans cette lutte on peut distinguer trois actions essentielles : la lutte contre le projet d'implantation d'une centrale au Cap Gris-Nez, la lutte contre l'installation de la centrale de Gravelines et aussi, en permanence, la contestation de fond contre le nucléaire en fonction des risques.
La lutte contre le projet Gris-Nez
L'implantation d'une centrale nucléaire au Cap Gris-Nez a été, dès le début, sérieusement envisagée par E.D.F.. Les aménagements prévus (voir schéma) étaient catastrophiques pour le site naturel du Cap.
Le projet prévoyait l'implantation de la centrale au niveau du Cran aux Œufs, par creusement dans la falaise. Les eaux de refroidissement étaient pompées dans la Manche et les eaux chaudes évacuées par un canal qui allait s'ouvrir au niveau des marais de Tardinghem sur la Mer du Nord. Le Cap Gris-nez était séparé de l'arrière-pays et toute la zone aurait été couverte de pylônes avec leurs lignes T.H.T.
Il n'y aurait plus eu de grand site national (ce qualificatif ne lui a été décerné que bien après). C'était un patrimoine perdu à jamais car le Gris-Nez était déjà inscrit à l'inventaire des sites nationaux à protéger depuis 1970.
Les Amis du Fort d'Ambleteuse et toute la Fédération NORD-NATURE ont donc réagi très vivement par courriers aux Préfets, aux élus, aux Ministres. Le Bulletin des A.F.A. a publié dans plusieurs de ses numéros, en 74-75, tous les détails sur cette "lamentable affaire". Mais la réaction la plus spectaculaire et la plus sympathique autant que symptomatique a été celle des habitants. Sur la proposition des A.F.A. qui avaient édité un autocollant "S.O.S. Gris-Nez", toutes les fenêtres des maisons et les vitres de voitures se sont ornées de cet autocollant. On le voyait partout de Sangatte à Boulogne.
Le rejet unanime du projet par la population a certainement au moins, et peut-être plus, influencé les décideurs, que toutes nos protestations orales ou manuscrites.
Pourtant le danger a persisté jusqu'au bout. Les visiteurs extérieurs qui venaient sur la côte étaient souvent résignés. "Il faut bien mettre les centrales quelque part...", entendait-on ! Le retrait du Gris-Nez de l'inventaire des sites à protéger était envisagé et le Ministre de l'environnement de l'époque, Monsieur Jarrot, à qui la question était posée lors d'une visite à l'Agence de l'Eau à Douai, avait répondu de même. "Il faut ces centrales nucléaires et il faut bien les mettre quelque part". Quant à l'Agence de l'Eau, elle-même, son Comité de Bassin avait en juillet 75 émis un avis favorable ; cet avis ne concernait que les problèmes d'eau mais il était tout de même de poids (il n'est pas abusif de noter au passage que le Président de ce Comité de Bassin était aussi le Président de la Commission interdépartementale pour le barrage de la Baie de Canche).
Et c'est finalement le Préfet du Pas-de-Calais, dans une allocution en Mairie de Marquise, qui a donné la nouvelle : l'abandon du projet de centrale au Gris-Nez. C'était le 27 octobre 1976, ce qui m'a été confirmé (lettre au Président de NORD-NATURE) par le Préfet lui-même, sur ma demande, le 9 novembre 1976.
Le pire avait été évité. Le Gris-Nez était sauvé mais Gravelines restait.
La lutte contre Gravelines
Le projet de centrale nucléaire de Gravelines était sur les rails depuis le début (la Région avait écarté le site d'Oye-Plage un moment proposé par E.D.F.).
Toutes les Associations, locales et régionales, se sont évidemment mobilisées contre le nucléaire, essentiellement, le Comité antipollution de Dunkerque (Président : Casanovas), les Amis de la Terre de Lille (Président : P. Radanne), l'ADELFA (Président : J.C. Bruneel), Vallée de Lys-Nature (Président : M.Tirmont), Béthune-Nature (Président : R. Trouvilliez) et, bien entendu, la Fédération NORD-NATURE.
Tout le monde est monté au créneau. Le nombre de conférences effectué est considérable et a couvert presque toute la région. Rien qu'en 1975, j'ai personnellement effectué, sur ce sujet, des conférences à Boulogne, Lille, Roubaix, Fives, Bourbourg, Calais ; d'autres (M. Porchet, St Deblock,...) sont également intervenus ailleurs. J'ai aussi, cette même année, sur l'invitation de Pierre Mauroy, participé à une séance d'information et débats devant le Conseil Régional et le Conseil économique et social réunis dans le grand salon de la Préfecture ; je suis intervenu, au nom de NORD-NATURE, aux côtés de personnalités nationales pro-nucléaires (un ingénieur du C.E.A., un ingénieur d'E.D.F. et le Professeur Louis Leprince-Ringuet du Comité de l'énergie atomique).
Bien évidemment, face à ces hautes personnalités et techniciens de l'atome, je n'ai pas convaincu ; je me souviens de deux questions : l'une sérieuse et intéressée de Maurice Schumann sur mon opinion à propos du projet d'implantation d'une usine d'enrichissement d'uranium à Calais... , l'autre, posée avec un certain mépris ironique par un élu de l'Avesnois, sur mon opinion quant aux risques pour le "sanglier des Ardennes" proche de la centrale de Chooz...
Beaucoup d'autres interventions ont été effectuées : pétitions, articles adressés à la presse régionale, interviews radios locales et télévision (j'ai même participé, à Gravelines même, à l'enregistrement d'une émission télévisée par une chaîne anglaise). L'activité médiatique a été intense. Des articles ont aussi paru dans des périodiques nationaux (ex. dans "l'École Libératrice", organe de la M.G.E.N. : voir biblio).
En 1976, j'ai fait, pour ma part, cinq conférences sur le sujet : à Lille (dont deux au Rotary Club), à Béthune et à Roubaix ; St. Deblock en a effectué quatre (à Béthune, Cambrai, Wervicq-Sud et Lille) et il a rédigé un numéro remarquablement documenté de notre bulletin "Spécial Énergie nucléaire" qui, malgré son abondant tirage, a été épuisé très vite. Il est à noter aussi que, dans nos conférences, la référence à des énergies propres et renouvelables était toujours présente.
Cette action contre le nucléaire a connu également plusieurs manifestations publiques à Lille, à Gravelines ; mais la plus importante a été celle du 28 mai 1977.
A l'appel de NORD-NATURE, des Amis de la Terre de Lille et du Comité antipollution de Dunkerque, un grand rassemblement a eu lieu sur la place centrale de Gravelines ; là, des personnes de tout âge et de toute condition, du barbu hippie au monsieur en costume-cravate, de la grand-mère à la maman poussant la voiture de son enfant, la foule s'est mise en marche vers la centrale. Combien de manifestants ? 3 à 4000 selon les associations, 2 à 3000 selon la police, quoi qu’il en soit les premiers arrivaient à la centrale alors que les derniers quittaient à peine le bourg de Gravelines, avec banderoles et scandant slogans.
Des responsables des diverses organisations étaient là ; j'étais l'un de ceux-ci, aidé de M. Tirmont, de R. Trouvilliez et de quelques autres. J'en garde un souvenir vivace. Arrivés devant les portes de la centrale en construction, on s'est donc tassés sur la route et les côtés, face à des escadrons de C.R.S. armés qui nous interdisaient l'entrée.
Après de vaines réclamations, pour entrer, les manifestants se sont répandus de chaque côté de la grande grille d'entrée et n'écoutant pas les appels au calme des responsables, s'accrochant aux grillages de trois mètres de hauteur, ont, en quelques secondes, abattu grillages et poteaux de ciment.
La force d'une foule est immense et jamais je n'aurais imaginé que cela puisse se produire. En tous cas ce n'était pas prévu, d'où notre affolement de responsables car les C.R.S. menaçaient de tirer et leur capitaine paraissait très énervé. Alors, sans qu'on ait le temps de se concerter, les principaux responsables ont tenté de calmer les manifestants pour éviter une tragédie, et le Commissaire de Police qui nous accompagnait depuis Gravelines est intervenu auprès du capitaine C.R.S. Après d'âpres négociations, les forces de l'ordre ont accepté de nous laisser pénétrer de dix mètres dans l'enceinte de la centrale, mais pas un centimètre de plus.
Le calme est revenu, d'autant que d'autres compagnies de C.R.S. apparaissaient à l'avant et autour.
Un sit-in a été décidé et les manifestants, après une heure ou deux de présence, ont commencé à regagner Gravelines par petits groupes.
La manifestation avait été un succès par le nombre, par la détermination et, finalement, par le calme revenu.
J'ai fait ouf ! mais c'est une expérience que je n'oublierai pas.
Après ?...
L'enquête publique concernant les rejets de la centrale de Gravelines a été ouverte du 9 au 30 janvier 1979. Je me suis rendu à Gravelines où pendant environ deux heures, j'ai écrit à la main sur le registre, les observations de NORD-NATURE ; ces observations sont rapportées dans notre bulletin (fasc.14, 1979). En plus des milliers de signatures par pétitions étaient déposées (environ 100.000).
Il y a eu d'autres manifestations par la suite. En 1980 fut organisée par divers groupes une marche Lille-Gravelines de quatre jours. NORD-NATURE y était représentée, entre autres, par Robert Trouvilliez, Michel Tirmont et Jacqueline Istas. Parmi les responsables d'autres groupes, il y avait Alain Trédez et Alain Vaillant qui devaient plus tard s'investir au sein de notre fédération et au cours de la manifestation, Alain Vaillant présenta à Armentières, Steenwerck et Cassel un chauffe-eau solaire en fonctionnement de sa fabrication. La marche se déroula sans affrontements et se termina à Gravelines par un "dying", simulation d'accident nucléaire que la presse qualifia "d'impressionnante".
Mais le bulldozer nucléaire (Gouvernement, E.D.F., C.E.A.) était le plus fort : la Déclaration d'Utilité Publique étant parue, la mise en route des réacteurs avait lieu en mai 1980.
Une dernière manifestation a cependant été organisée par divers mouvements non violents avec la participation de Nord-Nature : une marche Lille-Gravelines a lieu du 1er au 4 mai 1980. Après une courte allocution de ma part à Lille, la marche s’est effectuée sans problème ; Nord-Nature y était représentée par Jacqueline Istas, Robert Trouvilliez, Michel Tirmont et Jean-Claude Bruneel. Mais ces manifestations étaient vaines.
Bien sûr on a tenté de s'opposer par voie juridique. Le premier recours de NORD-NATURE au Tribunal administratif a été rejeté, le deuxième, effectué devant le Conseil d'État par l'Association antipollution de Dunkerque (membre de NORD-NATURE) a bien réussi et a annulé l'autorisation des rejets mais... le Gouvernement a pris quinze jours avant le jugement, un nouvel arrêté d'autorisation (voir Bull.NN, fasc.28, p.282).
La force est restée au plus fort.
La centrale de Gravelines, de quatre réacteurs au début, est passée à six (1981)... ce sont les deux réacteurs, prévus au Gris-Nez, qui sont passés à Gravelines : elle tourne depuis trente ans. Jusqu'à quand ?
Les autres luttes antinucléaires
Elles sont permanentes.
D'abord le projet d'usine d'enrichissement d'uranium à CALAIS n'a pas abouti. Heureusement !
Mais les problèmes d'accidents, d'incidents, de déchets, restent. Que faire d'autre que protester, informer, sensibiliser ? On sait maintenant que le nucléaire civil dont E.D.F. se vantait, avant 1975, qu'il n'avait tué personne, peut tuer.
Demain, il faudra fermer nos centrales obsolètes. E.D.F. a commencé ses campagnes pour une nouvelle génération nucléaire. Il y a encore du travail. Mais c'est par la démonstration que des énergies alternatives peuvent réussir, qu’on réussira peut-être à modifier les choses (voir plus loin le chapitre sur l'énergie).
Références
- Les dangers de l'électricité nucléaire pour l'environnement et l'homme, E. Vivier, l'Ecole Libératrice 1975, 28, 1387/1390
- Le problème énergétique et ses aspects régionaux, E. Vivier, Bull. NN, 1976, n° 5, p.56-62
- Une lamentable affaire, par J. Méreau, Bull. A.F.A., n° 23, 1976 24, 1976, p.9-19, n° 24, 19763, p.9-19, n° 25, 1976, p.6-16, n° 26, 1977, p.9-31, n° 27, 1977, p.19-22
- Spécial énergie nucléaire, St. Deblock, Bull. NN., "Spécial" 1976, 100 pages
- Biologie et énergie nucléaire, E. Vivier, L'Ecole libératrice, Bull; M.G.E.N., 1978
- L'enquête d'utilité publique sur les rejets de la centrale atomique de Gravelines, St. Deblock, Bull. NN, 1978, n° 14, p.23-30
- Les effluents radioactifs de la centrale de Gravelines, E. Vivier, (d'après le dossier E.P.), Bull. NN, 1979, n° 14, p.14-22
- Gravelines : les lois et nos recours en justice, E. Vivier, Bull. NN, 1980, n° 18, p.9-10
- Scandaleux tour de passe-passe à propos de la centrale nucléaire de Gravelines., E. Vivier. Bull. NN, 1982, fasc.28, p.11-13
| Vite . . . la suite |
Fédération Nord Nature, 23 rue Gosselet, 59000 LILLE - Tel 03.20.88.49.33 - - mail : webmaster@nord-nature.org